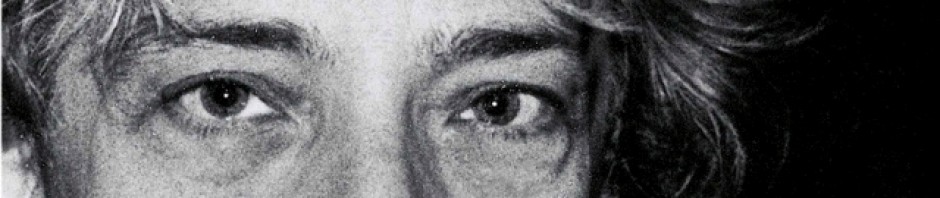Le budget, c’est l’instrument de l’avenir d’une nation, d’un pays, mais pas celui qui est proposé par nos Premiers ministres, pas un budget personnel négocié dans le souk. Ce qui va faire que la France va redevenir une (bonne) société, c’est un budget qui va être présenté aux citoyens une fois que des décisions démocratiques auront pu redéfinir, confirmer un projet de société qui va impliquer et enthousiasmer tous les citoyens. Un budget qui sert à financer des institutions consensuelles, sur la santé, l’éducation, la sécurité, mais pas un budget dont le seul but est de pallier la multiplication des erreurs de fonctionnement.
En fait, le déficit budgétaire dont on nous rebat les oreilles recouvre deux concepts : le déficit annuel, toutes le dépenses que nous ne pouvons pas financer avec les rentrées d’argent du gouvernement, pour lesquelles nous devons emprunter et le déficit cumulé, c’est à dire la dette, les sommes que le pays doit à tous nos prêteurs. On comprend que ce dernier est l »addition des premiers.
Autour de ces notions, il y en a beaucoup d’autres : à qui empruntons-nous ? Aux Français ou à d’autres pays ? Pourquoi empruntons-nous ? Et surtout : pourquoi dépensons-nous ?
L’ancien merveilleux Premier ministre du Québec, Jacques Parizeau disait que nous réfléchissons à l’envers quand nous nous posons l’éternelle question : « pouvons-nous nous payer tel service? » Pour lui, il s’agit, au sein d’une nation, de penser à ce que nous voulons d’abord, pour ensuite trouver le moyen de le financer intelligemment. La France a défini des principes sociaux équitables, établi des institutions pour garantir ces principes, santé, éducation, périodes de pause, horaires de travail, égalité entre femmes et hommes et entre citoyens et bien d’autres magnifiques principes. Tout cela a été défini en 1789 et avant et par la suite par Napoléon et ses merveilleux juristes, par de Gaulle et bien d’autres, Simone Veil par exemple ou Robert Badinter. Nous sommes devenus une Nation.
Ce sont les budgets, ce que les citoyens « physiques » ou « moraux » versent à l’État qui financent notre société. Si nous ne voulons ou ne « pouvons » plus (j’en doute) financer notre société, alors il faut en créer une nouvelle et certainement pas une qui ne rembourse plus que la moitié de la santé, la moitié de l’enseignement, la moitié de l’égalité et qui filoute quelques euros sur vos états de compte. Au 21 è siècle, alors que nous sommes plus riches que jamais et que nous disposons de moyens techniques extraordinaires, dire que nous ne pouvons plus financer notre société comme nous financions celle créée de1936 ou celle de 1970 est un gros mensonge.
Ce qui blesse en France. c’est souvent ce manque de discernement, cette brume soufflée par les gouvernements qui s’abstiennent de répondre à la question dans son intégralité en prédisant que la banque va sauter.
Il faudrait être naïf pour croire que raboter 42 milliards çà et là dans les dépenses publiques règlerait les deux déficits. Tant que le budget annuel sera déficitaire, la dette augmentera…Dès l’an prochain, il faudrait encore raboter au moins les mêmes services, probablement plus en tenant compte de l’inflation et de dépenses supplémentaires (armement) et encore plus si les rentrées d’argent diminuent en raison d’une baisse de l’activité économique. Même ces coupures ne suffiront pas à stopper l’accroissement de la dette.
Nous vivons dans l’espoir qu’un boom économique va provoquer un tsunami de revenus pour l’État, mais les crises se succèdent et nous laissent dans le vieux système avec une dette qui ne peut que croitre dans un pays vieillissant, au fil de guerres et d’épidémies elles aussi en pleine croissance…en grande partie à cause de notre vieux système économique de consommation !
Plus de trois mille milliards. En soi, la dette représente un état des lieux de la société française telle qu’imaginée par les gouvernants. Que veut-on et comment veut-on le financer. On a compris que gratter les dépenses a une limite dans le temps. Si, dans cinq ans la « Sécu » ne rembourse que 40 % des dépenses, que les classes comptent désormais 45 ou 50 élèves, les économies de coupures risquent de se transformer en dépenses : moins de revenus pour ces fonctionnaires, baisse de qualité des prestations, dégradation de la santé publique, salaires réels en baisse et consommation qui baisse encore non volontairement pour préserver la nature, mais parce que le système économique est épuisé. Il faut donc revoir les concepts qui recouvrent ce sujet : que veut-on ? Plusieurs pays ont expérimenté le bon vieux truc de vendre les actifs étatiques les plus rentables : aéroports, autoroutes, énergie, mais il n’en reste plus et la dette est toujours là. On a même failli déplacer la gare de l’est à Paris…pour ajouter 100000 contribuables à Paris ? Citons aussi l’hôpital de Caen qui renvoie ses internes à cause d’un déficit de médecins pour les encadrer, mais comme les internes réduisaient considérablement le travail des médecins en recevant les patients ou rédigeant des ordonnances, les médecins se retrouvent devant une tâche encore plus lourdes.
L’idée de la gauche française de refaire une Constitution a de quoi séduire. Cela pourrait permettre aux citoyens de s’exprimer, à condition que ce processus se fasse dans un cadre bien défini : assemblées citoyennes organisées dans tout le pays, présence d’experts pour répondre aux questions et susciter le débat. L’ex-Premier ministre du Québec avait créé des « commissions régionales », immenses chantiers populaires pour définir la société québécoise auxquels tous les citoyens et tous les partis politique ont participé. Une nouvelle Constitution insoumise ou partisane n’a pas de sens et ce ne sont pas les monologues du grand Président devant des auditeurs béats qui vont refaire la République.
Il existe au 21ème siècle très peu de personnes aptes à diriger un pays. Trump, Poutine Xi – les pires, et d’autres n’y parviennent pas. Celles qui le pourraient encore ne font pas de politique. C’est un travail de citoyens, de travailleurs, de groupes, de régions, de classes, c’est un apprentissage de la compréhension des phénomènes mouvants des sociétés. Pour cela, il faudrait engager un processus de citoyenneté dès l’école comme cela se fait déjà en Norvège par exemple. En attendant de parfaire la politique citoyenne, nous pouvons au moins l’entreprendre. On nous dit que le peuple n’est pas prêt, mais cela fait tellement de temps qu’on nous le dit !
Ce n’est pas le sens civique que nous et nos enfants avons perdu : c’est le sens de notre vie en société. Nos solidarités sont intactes, nos volontés sont justes et éthiques. Elles sont à peine ébranlées par la violence et l’abandon social et par les crises, mais il suffira d’un souffle pour y revenir. Dans le cas qui nous occupe, nous n’avons plus besoin d’un énième Premier ministre mais plutôt d’une pause démocratique, d’un congé de République pour la redessiner, pour faire société une nouvelle fois, avec une implication forte de ce que nous appelions « la société civile », des citoyens.
Dès lors qu’un projet de société est élaboré, il peut être mis en place démocratiquement (on le fait différemment en Chine ou à Singapour, ce qui revient à poser une bombe sociale pour l’avenir. Un projet démocratique doit être sérieusement révisé, pas en changeant un ministre ou un président. Il ne s’agit plus de détails, mais bien de recréer un ensemble cohérent, puis un projet de financement. Et à ce compte, la dette importe moins puisqu’elle va précisément servir la solution, non plus les erreurs.